Glitch, bugs & hallucinations
L’exposition « Glitch, bugs & hallucinations » explore le glitch non pas comme une simple anomalie technique, mais comme un révélateur des structures invisibles qui régissent nos environnements numériques. Inspirée des réflexions de Marcello Vitali-Rosati* et de Rosa Menkman**, elle célèbre le glitch comme un espace de résistance à l’impératif fonctionnaliste de la technologie. Dans un monde où l’efficacité est devenue le mantra technologique, le glitch agit comme une interruption qui dévie les objets techniques de leurs formes et usages. Marcello Vitali-Rosati nous rappelle que le bug expose le fonctionnement interne des systèmes algorithmiques, dévoilant les rouages sousjacents qui manipulent notre expérience du monde numérique. À travers cette « faille », l’exposition dévoile l’idéologie des plateformes, en soulignant leur quête de perfection, de fluidité et de contrôle. Le glitch, en tant que dysfonctionnement, révèle la norme cachée : une course à l’optimisation qui repose sur des choix politiques et économiques déguisés en nécessités techniques.
* Marcello Vitali-Rosati, Éloge du bug, Zones, 2024
** Rosa Menkman, Glitch Studies Manifesto, 2010

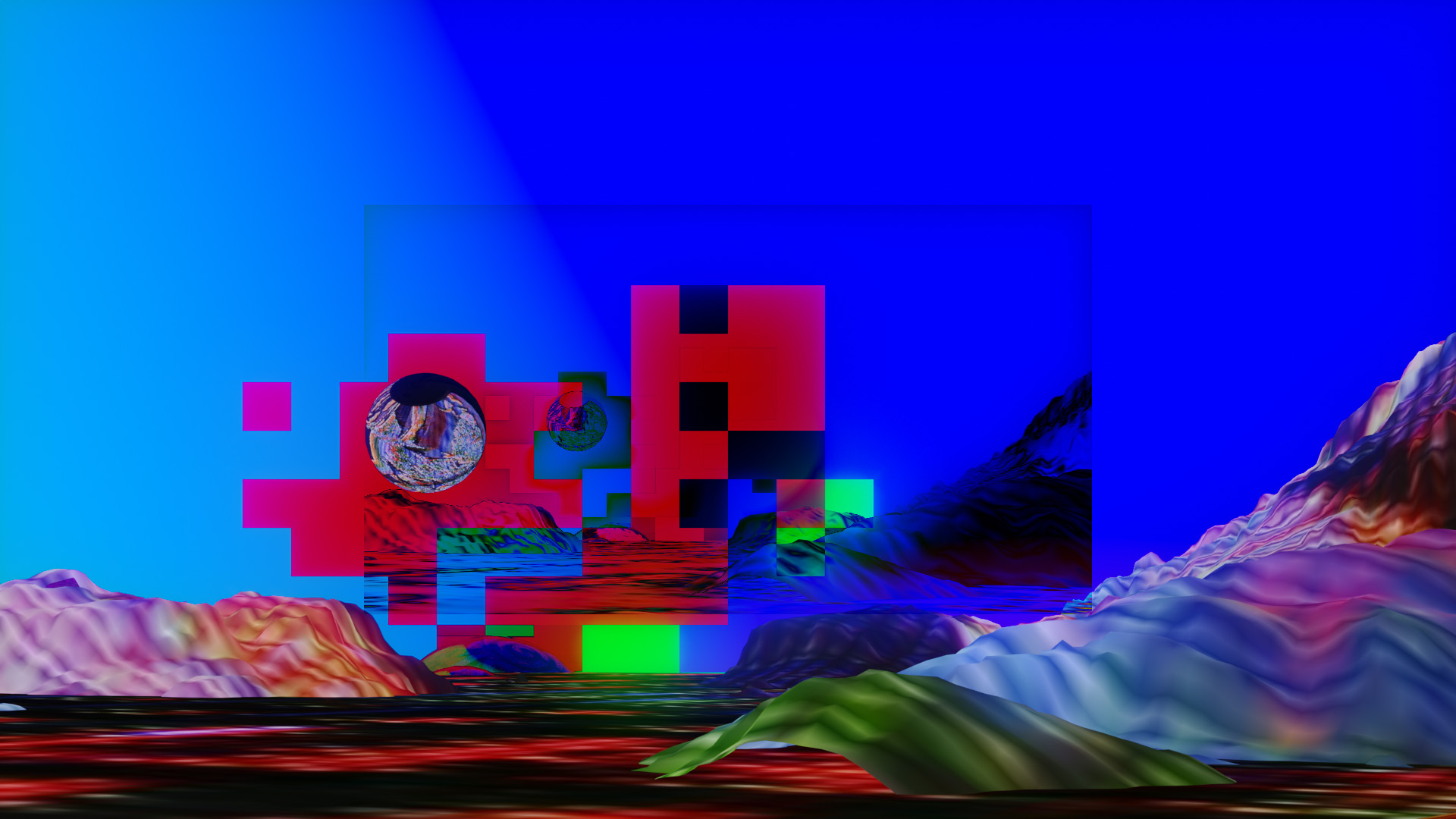
Loin d’être un échec, le glitch devient ici un outil subversif qui perturbe la matrice algorithmique et remet en question l’homogénéité des récits numériques tout en créant de nouvelles normalités. Rosa Menkman observe, dans le milieu du glitch art, comment les pratiques oscillent entre subversion et récupération, comment l’erreur devient à son tour elle-même une technique. En écho à ces observations, l’exposition nous invite à saisir la générosité destructrice du glitch art, tout en comprenant les différents cycles de domestication auxquels les artistes participent.
En regard à « Dopamine », cette exposition investit l’ensemble des espaces du Cube Garges, mêlant projections, tirages, installations, projets sonores, etc. Seront également exposées les machines interactives produites au Fablab par Arthur Chevalier, notamment à destination des enfants et des familles.

«̴͖̕ ̴̭͝͝Ő̷͍ṵ̴̤́̍p̹̰̊͘s̶̫̀ ̶̙͌̏»̴͖͗̈
Le bug, emprunté à la langue anglaise, vient du mot insecte. Il fait écho aux années 1940 où les ordinateurs pouvaient être si volumineux qu’une programmeuse informatique, Grace Hopper, a un jour trouvé la source d’une défaillance de sa machine dans un papillon de nuit s’étant glissé dans les circuits électromécaniques. Il avait fallu ouvrir l’ordinateur pour trouver l’insecte. Aujourd’hui, toutes nos machines sont dotées d’écrans et de hautparleurs qui manifestent la présence occasionnelle de bugs, aux causes diverses. Du clignotement erratique de l’écran aux sons parasites des haut-parleurs, c’est cette manifestation sensible, visuelle et sonore, qui forge, au-delà du phénomène électronique, une nouvelle notion plus subjective : celle du glitch. S’y conjugue le regard de l’humain avec la défaillance de la machine.

« Oups », c’est un mot commun du langage humain-machine en régime dysfonctionnel, c’est tout ce que l’on sait dire face à l’écran habité par le glitch. C’est notre manière à nous d’accepter le fait que la machine a repris le contrôle. La machine ne nous sert plus, et il y a là un renversement de pouvoir. Certains croisent les doigts en attendant que le bug se répare de lui-même ; d’autres éteignent leur machine pour ensuite la rallumer en espérant l’avoir remise à zéro, car nous sommes pour la plupart désarmés, sans savoir quoi faire réellement. D’autant plus qu’il est facile de se laisser captiver par les motifs hypnotiques et stroboscopiques à l’écran.
Le glitch est connu depuis l’informatique personnelle dans nos espaces privés, mais il prend une tout autre valeur lorsqu’il habite l’espace public. Lorsqu’il s’immisce dans un affichage publicitaire, par exemple, ou dans un des nombreux écrans du mobilier urbain, il rompt le quotidien de la fonctionnalité, il donne à percevoir une faille dans les institutions, les dispositifs qui règnent sur notre quotidien. Il nous arrive alors de les prendre en photo, comme pour capturer leurs échappées belles, et nous échapper avec eux. Ils deviennent en ce sens des vecteurs de résistance à la routine. Le glitch incarne alors une valeur antisystémique, non pas confinée au système qu’il habite, mais celui, plus large, du monde dans lequel nous vivons. Le glitch fait sourire, et devient le symbole
d’un monde où la technologie pourrait échapper à son propre contrôle. Dans ce contexte de résistance ludique, le Oups, qui exprime originellement la surprise et le regret du dysfonctionnement peut être maintenant dit avec ironie : « Oups ! », comme pour ridiculiser la situation et devenir un clin d’oeil complice face à la fragilité du numérique.
Kaspar Ravel

«̶͈̭͂̈̐̑̀͠Ǫ̸̼̯̽͜k̵̢̤͂̀̿é̷͙̥̣̒̑̌é̲̱̄̚é̵̵̩̗̮̫̠̮̈́̒̋̑̋»
Les machines nous entourant ne sont pas toujours aussi fonctionnelles que le laissent croire les entreprises qui les produisent. Avec le temps, parfois par design, nos outils se dégradent et sont sujets à des glitchs qui viennent empêcher leur bon fonctionnement. Leur usage devient alors le terrain de négociations permanentes entre l’humain et sa machine. Les glitchs, symptômes d’une affliction profonde, cachée dans les entrailles matérielles et logicielles de toute technologie, ne se laissant pas dompter facilement. On les résout alors comme on peut : parfois il suffit de tapoter sur le côté droit, ou de tordre le câble d’une manière particulière, pour arriver à ses fins et refaire marcher la machine.
« Okééé », c’est le moment intuitif où l’on comprend la cause d’un glitch sans forcément posséder la connaissance totale de ce qui se trame sous les coques opaques. C’est un eurêka populaire qui ne se vante pas d’être savant, mais qui a le mérite d’avoir acquis le geste qui provoque le glitch, ainsi que son geste contraire, celui qui le résout. « Okééé », c’est le point de départ des réparations bancales, d’une culture du DIY (Do It Yourself ou Fais-le-toi même en français), c’est une nouvelle page dans la bible des réparateurs et réparatrices du dimanche. Connaître ses machines de cette manière, c’est faire d’elles des outils « conviviaux », qui échappent une fois de plus à l’abandon et à la benne.
Mais que se passerait-il si, au lieu de réparer nos machines, on décidait de les maintenir dans l’état du glitch ? De trouver une manière subtile de stabiliser l’instabilité ? De capturer le moment exact entre le bon fonctionnement et la spirale de divergence ? Comme un funambule sur son fil, le bidouilleur ou la réparatrice devenus artistes de glitch, font un travail d’équilibriste pour maintenir la machine entre l’état de vie et de mort. Le glitch, présenté en tant qu’oeuvre d’art, joue alors un triple rôle : celui de témoin de l’existence même du glitch mais aussi de l’adresse dont témoigne l’artiste d’avoir su reproduire et maintenir ce même glitch, et finalement de partager avec le public le même « Okééé » originel vécu par l’artiste. Car la machine qui révèle le glitch révèle de manière codée ses dysfonctionnalités autant que son fonctionnement à toute personne qui lui prête cette attention. Cette transparence involontaire fascine et donne l’occasion à tous de comprendre et de prendre part dans la culture du glitch.
Kaspar Ravel

Les artistes de l’exposition
- Nick Briz
- Émilie Brout & Maxime Marion
- Ismaël Joffroy Chandoutis
- Arthur Chevalier
- Sky Goodman
- Jamie Fenton
- Aurélien Maignant
- Rosa Menkman
- OVAL
- Kaspar Ravel
- Sheglitchr
- Sabato Visconti
- Clément Valla
- Laimonas Zakas
- !Mediengruppe Bitnik
Infos pratiques :
- Dès 6 ans
- Gratuit sans réservation
- Aux jours et horaires d’ouverture du Cube Garges, du 25 octobre 2025 au 18 juillet 2026






