Dopamine
L’exposition Dopamine questionne les formes, perceptions et comportements façonnés par les plateformes numériques, là où le pouvoir ne s’impose plus frontalement mais s’infiltre par le geste doux, l’interface lisse, la boucle de récompense. À travers des installations techno-critiques et des oeuvres explorant les esthétiques virales de ces environnements, avec des gestes (swipe, double tap…), des postures (duckface, core communities…), des langages (emojis, mèmes, gifs…), elle agit comme un miroir grossissant. Ce trop-plein d’images, d’incitations, de joie un peu fausse comme dans les images shutterstock, révèle les limites de cette positivité algorithmique.
Les artistes, chercheurs et hackers invités y dévoilent aussi ce qui demeure souvent invisible : les mécanismes d’extraction de données, de profilage des usagers et de marchandisation de l’attention. Considérant Internet comme un commun, l’exposition explorera également les manières dont on peut se réapproprier ces plateformes, ainsi que des exemples concrets de design pensés pour définir d’autres modes de relation aux écrans.

Dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026.


Cette exposition a bénéficié du soutien de la Délégation générale du Québec à Paris
Économie affective, esthétisation du bien-être, et architecture de la fluidité
L’esthétique actuelle du numérique se définit par son absence de rugosité : les gestes glissent, les surfaces brillent, les couleurs sont douces, les voix synthétiques se veulent apaisantes, les relations humaines sont intermédiées… Le design ne cherche pas qu’à servir, il séduit, il attire ; il oriente l’attention dans un univers a priori sans résistance. Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han érige ce « lisse » en symbole de notre modernité, le considérant comme un mode de pouvoir par les apparences : l’esthétique est disciplinante. Elle évacue le négatif, gomme les aspérités, valorise la fluidité. En fait, elle intériorise la contrainte : rien ne nous force à agir, tout n’est qu’incitation. L’expérience utilisateur, conçue pour être « intuitive », neutralise les tensions — affective, politique ou sensorielle.

Ce design revêt une grande importance parce qu’il conditionne des gestes (swipe, double tap, doomscrolling, like…), des langages (emoji, mèmes, GIFs…) et des comportements. Mais il s’insinue plus loin encore. L’économie des plateformes numériques s’appuie sur la mise au travail des affects : les émotions ne sont plus seulement vécues, elles sont mises en scène, mesurées, guidées, transformées en ressources. Logique se prolongeant même dans le rapport qu’on entretient à notre corps. Filtres, routines de self-care, quantified self via bracelets connectés ou applications de santé : l’infrastructure concourt à produire un moi positif, désirable, performant. Ainsi, les algorithmes de TikTok, YouTube, Instagram ou Spotify sont des machines prédictives qui ne se contentent pas de suggérer : ils fabriquent nos préférences, selon des logiques opaques et souvent biaisées, renforçant parfois stéréotypes et inégalités de visibilité.
C’est à cette esthétique toute particulière que se réfère l’exposition, tout en la détournant. Les artistes exposés ne cherchent pas à en sortir, mais à l’amplifier jusqu’à la distorsion. À la manière d’un miroir grossissant, elles et ils poussent les codes jusqu’à les faire basculer dans l’étrange, l’excessif. Là où tout devait être fluide surgissent des saturations ; là où tout devait être doux, une violence feutrée. En forçant les formes jusqu’à l’excès, ces oeuvres rendent visibles les contours parfois aliénants de ce monde de « fluidité », de « transparence » et de « bienveillance ».

De Minitel à Liquid Glass, une brève histoire des designs d’interface
L’esthétique d’Internet — ses images et ses sons, ses modes de circulation, la manière dont l’information se rend visible, interactive, partageable — est indissociable des interfaces qui conditionnent nos gestes numériques. C’est donc assez spécifiquement une question de design qui régit ce qui est possible et ne l’est pas en ligne, et crée en cela, avec la foule des utilisateurs et utilisatrices, l’esthétique, voire les esthétiques des Internets. Dès 2001, Lev Manovich* montrait combien les conventions d’interface façonnent nos pratiques culturelles en instituant des normes visuelles et interactionnelles implicites. Des chercheurs comme Matthew Fuller** ou Wendy Hui Kyong Chun*** ont poursuivi cette réflexion en montrant que le code et l’interface sont co-producteurs, à la fois d’esthétique et d’idéologie.
Le design, en ce sens, n’est jamais neutre : il répond à des fonctions spécifiques, à des intentions souvent invisibles – qu’il s’agisse d’optimiser l’usage, de capter l’attention ou de faciliter la monétisation. Chaque esthétique d’interface témoigne ainsi d’un « esprit du temps » technologique, au croisement de l’industrie numérique, de la culture visuelle et des imaginaires sociaux.
* Lev Manovich, The language of new media, 2002
** Matthew Fuller, Software studies: A lexicon. MIT Press, 2008
*** Wendy Hui Kyong Chun, Programmed Visions: Software and Memory, MIT Press, 2011

Avec l’essor du flat design, les grandes plateformes (Google, Apple, Facebook…) ont mis en place des guidelines strictes, réduisant la variabilité graphique au profit d’une plus grande lisibilité pour les usagers et d’une performance fonctionnelle. Cette rationalisation visuelle va de pair avec une normalisation des comportements, transformant les interfaces en environnements toujours plus prévisibles, fermés et gouvernés par des logiques propriétaires. Mais cette homogénéisation se heurte à une réalité plus composite — dont témoigne cette exposition. Dès les années 1990, des artistes issus du net.art ont mis en évidence ce que Olia Lialina nomme les vernacular web aesthetics : des formes d’expression amatrices, souvent dissonantes ou bricolées, issues de l’appropriation spontanée des outils numériques par les usagers eux-mêmes. Produites par détournement, contre emploi ou débordement des cadres imposés, ces esthétiques révèlent que l’interface reste un champ de négociation, traversé par une tension constante entre prescription algorithmique et inventivité populaire.
Il existe donc une friction constitutive entre, d’un côté, les logiques de contrôle et de design stratégique — visant à standardiser l’expérience, surveiller les usages ou maximiser l’engagement attentionnel — et, de l’autre, la vitalité des pratiques, l’appropriation collective et les formes d’hétérogénéité esthétique qui persistent malgré tout. Cette tension rappelle qu’en dépit de plateformes de plus en plus enclosantes, Internet demeure un commun — un espace encore habité, transformé, dérouté par celles et ceux qui le pratiquent.

Sous l’oeil du Big Other, le pouvoir invisible des plateformes
Vous souvenez-vous d’Aladin ? Le philosophe Marcello Vitali-Rosati* compare notre relation aux plateformes à celle que le héros des Mille et Une Nuits entretient avec son génie. D’abord, parce qu’il ignore tout du fonctionnement de la lampe magique, si ce n’est le geste qui l’actionne : la frotter. Et lorsqu’il demande à devenir prince, c’est bien le génie qui choisit son costume et son apparence. Aladin profite donc des services du génie, mais sans décider de la manière dont ils sont rendus. De manière similaire, lorsque nous déléguons nos choix à des algorithmes — moteurs de recherche, suggestions automatisées, assistants vocaux, etc. Nous ne savons pas réellement ce qui décide pour nous, ni selon quelles logiques, ni dans quel intérêt.
* Marcello Vitali-Rosati, Éloge du bug, Paris, La Découverte, 2024
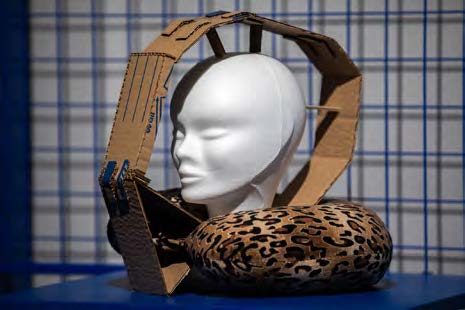

Cette fable rend visible une réalité importante : le numérique n’est pas un outil neutre, c’est une infrastructure construite avec des intentions particulières. Plateformes et applications ne se contentent pas de diffuser des contenus : elles organisent nos comportements, hiérarchisent nos désirs, trient nos représentations du monde. Autrefois pensé comme un espace d’émancipation libre et personnalisable (c’était l’époque de Geocities, de MySpace…), le web s’est refermé en un système dit d’enclosures. On emploie aujourd’hui ce terme pour désigner la privatisation d’un bien commun ; en l’occurrence, l’appropriation de données ou d’espaces numériques auparavant libres. Et c’est un système gigantesque. En 2025, 70 % de la population mondiale, soit plus de 5,5 milliards d’humains, est connectée à Internet : 3 milliards utilisent Facebook, 1,6 milliard TikTok, 2,7 YouTube, 1,3 WeChat… Sans surprise, en une dizaine d’années seulement, les plus grandes fortunes planétaires sont devenues leurs fondateurs : Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page (Google), Zhang Yiming (ByteDance), etc.

Ce modèle correspond à ce que l’économiste français Cédric Durand** nomme « techno-féodalisme », notion reprise par Yànis Varoufàkis, économiste et ancien ministre des Finances de la Grèce. Il s’agit d’une économie qui reprend les fondements du féodalisme : privatisation des communs et économie de rente, où les plateformes ne produisent pas de valeur au sens classique (travailmarchandise), mais l’extraient grâce à leur position de gardiens d’accès. Chaque clic, scroll, photo postée ou relation entretenue enrichit leurs bases de données, alimente leurs modèles prédictifs, et optimise le ciblage publicitaire. Cette dynamique constitue ce qu’on nomme le « digital labor » : c’est en utilisant les espaces en ligne qu’elles ont enclos que nous produisons de la valeur pour ces plateformes, en travaillant indirectement pour elles. Pour la psycho-sociologue étasunienne Shoshana Zuboff***, ce régime relève de ce qu’elle a nommé « Big Other » : une entité non étatique, mais totalisante, qui observe, anticipe et façonne les comportements à l’échelle globale. Contrairement au « Big Brother » du 1984 d’Orwell, ce Big Other ne gouverne pas par la peur, mais par la promesse de confort, de personnalisation, de service rendu. Un pouvoir d’autant plus efficace qu’il est invisible, délégué, et perçu comme utile et doux.
** Cédric Durand, Techno-féodalisme: Critique de l’économie numérique. La Découverte, 2023
*** Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Zulma, 2018
Les artistes de l’exposition
- Cameron Askin
- Alkan Avcıoğlu
- Émilie Brout et Maxime Marion
- Christophe Bruno
- DISNOVATION.ORG
- Ben Elliot
- Ben Grosser
- Hérétique
- Anne Horel
- Dasha Ilina
- Baron Lanteigne
- Ethel Lilienfeld
- Jonas Lund
- Shōei Matsuda
- Lorna Mills
- Jérémie Kursner
- Miri Segal
Infos pratiques :
- Dès 6 ans
- Gratuit sans réservation
- Aux jours et horaires d’ouverture du Cube Garges, du 27 septembre 2025 au 18 juillet 2026






